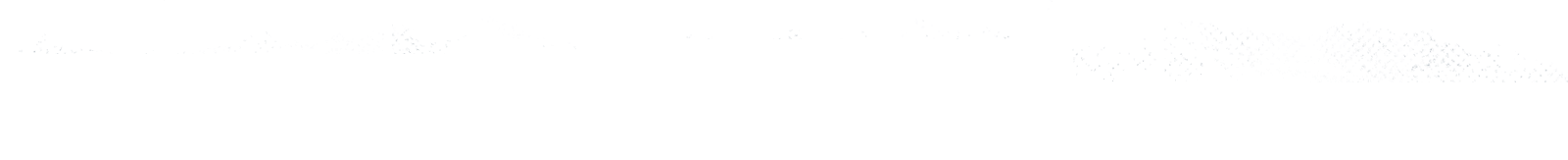Lorsque les sept hommes dont nous vous avons parlé plus haut eurent enterré dans Gwynvryn à Llundein la tête de Bendigeit Vran, le visage tourné vers la France, Manawyddan, jetant les yeux sur la ville de Llundein et sur ses compagnons, poussa un grand soupir et fut pris de grande douleur et de grand regret.
Lorsque les sept hommes dont nous vous avons parlé plus haut eurent enterré dans Gwynvryn à Llundein la tête de Bendigeit Vran, le visage tourné vers la France, Manawyddan, jetant les yeux sur la ville de Llundein et sur ses compagnons, poussa un grand soupir et fut pris de grande douleur et de grand regret.
« Dieu tout-puissant, » s’écria-t-il, « malheur à moi ! Il n’y a personne qui n’ait un refuge cette nuit, excepté moi ! »
– « Seigneur,» dit Pryderi, « ne te laisse pas abattre ainsi. C’est ton cousin germain qui est roi de l’île des Forts. En supposant qu’il puisse avoir eu des torts vis-à-vis de toi, il faut reconnaître que tu n’as jamais réclamé terre ni possession; tu es un des trois qui sont princes sans l’être. »
– « Quoique cet homme soit mon cousin, » répondit Manawyddan, « il est toujours assez triste pour moi de voir qui que ce soit à la place de mon frère Bendigeit Vran. Je ne pourrai jamais être heureux dans la même demeure que lui. »
– « Veux-tu suivre un conseil? »
– « J’en ai grand besoin; quel est-il ce conseil ? »
– « Sept cantrevs m’ont été laissés en héritage; ma mère Riannon y demeure. je te la donnerai et avec elle les sept cantrevs. Ne t’inquiète pas quand même tu n’aurais pas d’autres possessions; il n’y en a pas au monde de meilleurs. Ma femme est Kicva, la fille de Gwynn Gohoyw. Les domaines seront à mon nom, mais vous en aurez la jouissance, toi et Riannon. Si tu désirais jamais des domaines en propre, tu pourrais prendre ceux-là. »
– « Non jamais, seigneur Dieu te rende ta confraternité ! »
– « Si tu veux, toute l’amitié dont je suis capable sera pour toi. »
– « J’accepte, mon âme : Dieu te le rende. Je vais aller avec toi voir Riannon et tes états. »
– « Tu as raison; je ne crois pas que tu aies jamais entendu femme causant mieux qu’elle. A l’époque où elle était dans la fleur de la jeunesse, il n’y en avait pas de plus parfaite, et maintenant encore son visage ne te déplaira plus. »
Ils partirent aussitôt, et, quelle qu’ait été la longueur de leur voyage, ils arrivèrent en Dyvet. Ils trouvèrent festin préparé à leur intention en arrivant à Arberth; c’était Riannon et Kicva qui l’avaient organisé. Ils se mirent tous à table ensemble et Manawyddan et Riannon causèrent. Cet entretien lui inspira pour elle de tendres sentiments et il fut heureux de penser qu’il n’avait jamais vu de femme plus belle ni plus accomplie.
– « Pryderi, » dit-il, « je me conformerai à tes paroles. »
– « Quelles paroles? » demanda Riannon.
– « Princesse, » répondit Pryderi, « je t’ai donnée comme femme à Manawyddan fils de Llyr. »
– « J’obéirai avec plaisir, » dit Riannon.
– « Et moi aussi, » dit Manawyddan. « Dieu récompense celui qui me témoigne une amitié aussi solide. » Avant la fin du banquet, il coucha avec elle.
– «Jouissez, » dit Pryderi, « de ce qui reste du festin. Moi, je m’en vais aller porter mon hommage à Kasswallawn, fils de Beli, en Lloegyr. »
– « Seigneur, » répondit Riannon, « Kasswallawn est en Kent. Tu peux terminer ce banquet et attendre qu’il soit plus près. »
– « Nous attendrons donc, » dit-il. Ils achevèrent le banquet et ils se mirent à faire leur tour de Dyvet, à chasser, à prendre plaisir. En circulant à travers le pays, ils constatèrent qu’ils n’avaient jamais vu pays plus habité, meilleur pays de chasse, mieux pourvu de miel et de poisson. Leur amitié à tous les quatre grandit ainsi à tel point qu’ils ne pouvaient se passer les uns des autres ni jour ni nuit.
Entre temps, Pryderi alla porter son hommage à Kasswallawn à Ryt-ychen. Il y reçut un excellent accueil et on lui fut reconnaissant de son hommage. Lorsqu’il fut de retour, Manawyddan et lui se mirent aux festins et aux délassements. Le festin commença à Arberth; c’était la principale cour et c’était toujours par elle que commençait toute cérémonie. Après le premier repas, ce soir-là, pendant que les serviteurs étaient en train de manger, ils sortirent tous les quatre et se rendirent avec leur suite au Tertre d’Arberth. Comme ils y étaient assis, un grand coup de tonnerre se fit entendre, suivi d’un nuage si épais qu’ils ne pouvaient s’apercevoir les uns les autres. La nuée se dissipa et tout s’éclaircit autour d’eux. Lorsqu’ils jetèrent les yeux sur cette campagne où auparavant on voyait troupeaux, richesses, habitations, tout avait disparu, maison, bétail, fumée, hommes, demeures; il ne restait que les maisons de la cour, vides, sans aucune créature humaine, sans un animal. Leurs compagnons mêmes avaient disparu sans laisser de traces; ils ne restaient qu’eux quatre.
« Oh ! Seigneur Dieu ! » s’écria Manawyddan, « où sont les gens de la cour ? Où sont tous nos autres compagnons? Allons voir. » Ils se rendirent à la salle personne; à la chambre et au dortoir : personne; à la cave à l’hydromel, à la cuisine : tout était désert. Ils se mirent tous les quatre à continuer le festin, à chasser, à prendre leur plaisir. Chacun d’eux parcourut le pays et les domaines pour voir s’ils trouveraient des maisons et des endroits habités, mais ils n’aperçurent, rien que des animaux sauvages. Le festin et les provisions épuisés, ils commencèrent à se nourrir de gibier, de poisson, de miel sauvage. Ils passèrent ainsi joyeusement une première année, puis une deuxième, mais à la fin la nourriture commença à manquer.
« Nous ne pouvons en vérité, » dit Manawyddan, « rester ainsi. Allons en Lloegyr et cherchons un métier qui nous permettre de vivre. »
Ils se rendirent en Lloegyr et s’arrêtèrent à Henffordd. Ils se donnèrent comme selliers.
Manawyddan se mit à façonner des arçons et à les colorer en bleu émaillé comme il l’avait vu faire à Llasar Llaesgygwyd. Il fabriqua comme lui l’émail bleu, qu’on a appelé calch lasar du nom de son inventeur, Llasar Llaesgygwyd. Tant qu’on en trouvait chez Manawyddan, on n’achetait dans tout Henffordd à aucun sellier ni arçon ni selle; si bien que les selliers s’aperçurent que leurs gains diminuaient beaucoup ; on ne leur achetait rien que quand on n’avait pu se fournir auprès de Manawyddan. Ils se réunirent tous et convinrent de tuer Manawyddan et son compagnon. Mais ceux-ci en furent avertis et délibérèrent de quitter la ville.
« Par moi et Dieu, » dit Pryderi, « je ne suis d’avis de partir, mais bien de tuer ces vilains-là. »
– « Non pas, » répondit Manawyddan; « si nous nous battions avec eux, nous nous ferions une mauvaise réputation et on nous emprisonnerait. Nous ferons mieux d’aller chercher notre subsistance dans une autre ville.»
Ils se rendirent alors tous les quatre à une autre cité.
« Quel métier professerons-nous? » dit Pryderi.
– « Faisons des boucliers, » répondit Manawyddan.
– « Mais y connaissons-nous quelque chose ? »
– « Nous essaierons toujours. » Ils se mirent à fabriquer des écus ; ils les façonnèrent sur le modèle des bons qu’ils avaient vus et leur donnèrent la même couleur qu’aux selles. Ce travail leur réussit si bien qu’on n’achetait un écu dans toute la ville que lorsqu’on n’en avait pas trouvé chez eux. Ils travaillaient vite; ils en firent une quantité énorme; ils continuèrent jusqu’à ce qu’ils firent tomber le commerce des ouvriers de la ville et que ceux-ci s’entendirent pour chercher à les tuer. Mais ils furent avertis; ils apprirent que ces gens avaient décidé leur mort.
« Pryderi, » dit Manawydan, « ces hommes veulent nous tuer. »
– « Ne supportons point pareille chose, » répondit-il, « de ces vilains; marchons contre eux et tuons-les. »
– « Non point ; Kaswallawn et ses hommes l’apprendraient ; nous serions perdus. Allons dans une autre ville. »
Ils arrivèrent dans une autre ville.
« A quel art nous mettrons-nous maintenant, » dit Manawyddan?
« A celui que tu voudras de ceux que nous savons, » répondit Pryderi.
« Non point; faisons de la cordonnerie. Des cordonniers n’auront jamais assez d’audace pour chercher à nous tuer ou à nous créer des obstacles. »
« Mais moi, je n’y connais rien. »
« Je m’y connais moi, et je t’apprendrai à coudre. Ne nous mêlons pas de préparer le cuir, achetons-le tout préparé et mettons-le en œuvre. » Il se mit à acheter le cordwal le plus beau qu’il trouva dans la ville; il n’achetait pas d’autre cuir excepté pour les semelles. Il s’associa avec le meilleur orfèvre de la ville; il lui fit faire des boucles pour les souliers, dorer les boucles, et le regarda faire jusqu’à ce qu’il eût appris lui-même. C’est à cause de cela qu’on l’a surnommé un des trois cordonniers-orfèvres. Tant qu’on trouvait chez lui soulier ou chaussure, on n’en achetait chez aucun cordonnier dans toute la ville. Les cordonniers reconnurent qu’ils ne gagnaient plus rien. A mesure que Manawyddan façonnait, Pryderi cousait. Les cordonniers se réunirent et tinrent conseil; le résultat de la délibération fut qu’ils s’entendirent pour les tuer.
« Pryderi », dit Manawyddan,« ces gens veulent nous tuer. »
« Pourquoi supporter pareille chose », répondit Pryderi, « de ces voleurs de vilains ? Tuons-les tous. »
« Non pas », dit Manawyddan; « nous ne nous battrons pas avec eux et nous ne resterons pas plus longtemps en Lloegyr. Dirigeons-nous vers Dyvet et allons examiner le pays. »
Quelque temps qu’ils aient été en route, ils arrivèrent à Dyvet et se rendirent à Arberth. Ils y allumèrent du feu, et se mirent à se nourrir de gibier ; ils passèrent un mois ainsi. Ils rassemblèrent leurs chiens autour d’eux et vécurent ainsi pendant une année. Un matin, Pryderi et Manawyddan se levèrent pour aller à la chasse; ils préparèrent leurs chiens et sortirent de la cour. Certains de leurs chiens partirent devant et arrivèrent à un petit buisson qui se trouvait à côté d’eux. Mais à peine étaient-ils allés au buisson qu’ils reculèrent immédiatement, le poil hérissé et qu’ils retournèrent vers leurs maîtres.
« Approchons du buisson, » dit Pryderi, « pour voir ce qu’il y a. » Ils se dirigèrent de ce côté, mais quand ils furent auprès, tout d’un coup un sanglier d’un blanc éclatant se leva du buisson. Les chiens excités par les hommes s’élancèrent sur lui. Il quitta le buisson et recula à une certaine distance des hommes. Jusqu’à ce que les hommes fussent près de lui, il rendit les abois aux chiens sans reculer devant eux. Lorsque les hommes le serrèrent de près, il recula une seconde fois et rompit les abois. Ils poursuivirent ainsi le sanglier jusqu’en vue d’un fort très élevé, paraissant nouvellement bâti, dans un endroit où ils n’avaient jamais vu ni pierre ni trace de travail. Le sanglier se dirigea rapidement vers le fort, les chiens à la suite. Quand le sanglier et les chiens eurent disparu à l’intérieur, ils s’étonnèrent de trouver un fort là où ils n’avaient jamais vu trace de construction. Du haut du tertre, ils regardèrent et écoutèrent mais il eurent beau attendre, ils n’entendirent pas un seul chien et n’en virent pas trace.
« Seigneur, » dit Pryderi, « je m’en vais au château chercher des nouvelles des chiens. »
« Ce n’est pas une bonne idée, » répondit Manawyddan, « que d’aller dans ce château que tu n’as jamais vu. Si tu veux m’écouter, tu n’iras pas. C’est le même qui a jeté charme et enchantement sur le pays qui a fait paraître le château en cet endroit. »
« Assurément, je n’abandonnerai pas mes chiens, » dit Pryderi. En dépit de tous les conseils de Manawyddan, il se rendit au château. Il entra et n’aperçut ni homme, ni animal, ni le sanglier, ni les chiens, ni maison, ni endroit habité. Sur le sol vers le milieu du fort, il y avait une fontaine entourée de marbre, et sur le bord de la fontaine, reposant sur une dalle de marbre, une coupe d’or attachée par des chaînes qui se dirigeaient en l’air et dont il ne voyait pas l’extrémité. Il fut tout transporté de l’éclat de l’or et de l’excellence du travail de la coupe. Il s’en approcha et la saisit. Au même instant, ses deux mains s’attachèrent à la coupe et ses deux pieds à la dalle de marbre qui la portait. Il perdit la voix et fut dans l’impossibilité de prononcer une parole. Il resta dans cette situation.
Manawyddan, lui, attendit jusque vers la fin du jour. Quand le temps de nones touchait à sa fin et qu’il fut bien sûr qu’il n’avait pas de nouvelles à attendre de Pryderi ni des chiens, il retourna à la cour. Quand il rentra Riannon le regarda :
« Où est ton compagnon? » dit-elle. « Où sont les chiens? »
« Voici l’aventure qui m’est arrivé, » répondit-il. Et il lui raconta tout.
« Vraiment, » dit Riannon, « tu es mauvais camarade et tu en as perdu un bien bon ! » En disant ces mots, elle sortit. Elle se dirigea vers la région où il lui avait dit que Pryderi et le fort se trouvaient. La porte était ouverte; tout y était au grand jour. Elle entra. En entrant, elle aperçut Pryderi les mains sur la coupe. Elle alla à lui :
« Oh ! Seigneur, » dit-elle, « que fais-tu là ? » et elle saisit la coupe. Aussitôt, ses deux mains s’attachèrent à la coupe, ses deux pieds à la dalle, et il lui fut impossible de proférer une parole. Ensuite, aussitôt qu’il fut nuit, un coup de tonnerre se fit entendre, suivi d’un épais nuage, et le fort et eux-mêmes disparurent.
Kicva, fille de Gwyn Gohoyw, voyant qu’il ne restait plus dans la cour que Manawyddan et elle, en conçut tant de douleur que la mort lui semblait préférable à la vie. Ce que voyant, Manawyddan lui dit :
« Tu as tort, assurément, si c’est par peur de moi que tu es si affectée ; je te donne Dieu comme caution que je serai pour toi le compagnon le plus sûr que tu aies jamais vu, tant qu’il plaira à Dieu de prolonger pour toi cette situation. Par moi et Dieu, je serais au début de la jeunesse que je garderais ma fidélité envers Pryderi. Je la garderai aussi pour toi. N’aie pas la moindre crainte. Ma société sera telle que tu voudras, autant qu’il sera en mon pouvoir, tant qu’il plaira à Dieu de nous laisser dans cette situation pénible et cette affliction. »
« Dieu te le rende » répondit -elle; « c’est bien ce que je supposais.» La jeune femme en conçut joie et assurance.
« Vraiment », dit Manawyddan, « ce n’est pas le moment pour nous de rester ici : nous avons perdu nos biens, il nous est impossible d’avoir notre subsistance. Allons en Lloeger, nous trouverons à y vivre plus facilement. »
« Volontiers, Seigneur, » répondit-elle; « suivons ton idée. »
Ils marchèrent jusqu’en Lloegyr.
« Quel métier professeras-tu, seigneur? » dit-elle. « Prends-en un propre. »
« Je n’en prendrai pas d’autre », répondit-il, « que la cordonnerie, comme je l’ai fait auparavant. »
« Seigneur, ce n’est pas un métier assez propre pour un homme aussi habile, d’aussi haute condition que toi. »
« C’est cependant à celui-là que je me mettrai. » Il se mit à exercer sa profession; il se servit pour son travail du cordwal le plus beau qu’il trouva dans la ville. Puis, comme ils l’avaient fait ailleurs, ils se mirent à fermer les souliers avec des boucles dorées; si bien que le travail des cordonniers de la ville était inutile ou de peu de valeur auprès du sien. Tant qu’on trouvait chez lui chaussure ou bottes, on n’achetait rien aux autres. Au bout d’une année de cette existence, les cordonniers furent animés de jalousie et de mauvais desseins contre lui; mais il fut averti et informé que les cordonniers s’étaient entendu pour le tuer :
« Seigneur, » dit Kicva, « pourquoi supporter pareille chose de ces vilains? »
« Laissons, » répondit Manawyddan, « et retournons en Dyvet. » Ils partirent pour Dyvet.
En partant, Manawyddan emporta avec lui un faix de froment. Il se rendit à Arberth et s’y fixa. Il n’avait pas de plus grand plaisir que de voir Arberth et les lieux où il avait été chasser en compagnie de Pryderi et de Riannon. Il s’habitua à pendre le poisson et les bêtes sauvages dans leur gîte. Ensuite il se mit à labourer la terre, puis il ensemença un clos, puis un second, puis un troisième. Il vit bientôt se lever le froment le meilleur du monde et le blé de ses trois clos grandir de même façon; il était impossible de voir plus beau froment. Les diverse saisons de l’année passèrent; l’automne arriva. Il alla voir un de ses clos : il était mûr.
« Je moissonnerai celui-là demain. » dit-il. Il retourna passer la nuit à Arberth, et, au petit jour, il partit pour moissonner son clos. En arrivant, il ne trouva que la paille nue; tout était arraché à partir de l’endroit où la tige se développe en épi; l’épi était entièrement enlevé, il ne restait que le chaume. Il fut grandement étonné et alla voir un autre clos celui-là était mûr.
« Assurément, » dit-il, « je viendrai moissonner celui-ci demain. »
Le lendemain, il revint avec l’intention d’y faire la moisson : en arrivant, il ne trouva que le chaume nu.
« Seigneur Dieu », s’écria-t-il, « qui donc est ainsi à consommer ma perte? Je le devine : c’est celui qui a commencé qui achève et ma perte et celle du pays. » Il alla voir le troisième clos; il était impossible de voir plus beau froment, et celui-là aussi était mûr.
« Honte à moi, » dit-il, « si je ne veille cette nuit. Celui qui a enlevé l’autre blé viendra enlever aussi celui-ci; je saurai qui c’est. » Il avertit Kicva.
« Qu’as-tu l’intention de faire? » dit-elle,
« Surveiller ce clos cette nuit, » répondit-il. Il y alla.
Vers minuit, il entendit le plus grand bruit du monde. Il regarda : c’était une troupe de souris, la plus grande au monde, qui arrivait; il était impossible de les compter ni d’en évaluer le nombre. Avant qu’il ne pût s’en rendre compte, elles se précipitèrent dans le clos; chacune grimpa le long d’un tige, l’abaissa avec elle, cassa l’épi et s’élança avec lui dehors, laissant le chaume nu. Il ne voyait pas une tige qui ne fût attaquée par une souris et dont elles n’emportassent l’épi avec elles. Entraîné par la fureur et le dépit, il se mit à frapper au milieu des souris, mais il n’en atteignit aucune, comme s’il avait eu affaire à des moucherons ou à des oiseaux dans l’air. Il en avisa une d’apparence très lourde, au point qu’elle paraissait incapable de marcher. Il se mit à sa poursuite, la saisit, la mit dans son gant, dont il lia les extrémités avec une ficelle, et se rendit avec le gant à la cour.
Il entra dans la chambre où se trouvait Kicva, alluma du feu et suspendit le gant par la ficelle à un support.
« Qu’y a-t-il là, seigneur? » dit Kicva.
« Un voleur, » répondit-il, « que j’ai surpris en train de me voler. »
« Quelle espèce de voleur, seigneur, pourrais-tu bien mettre ainsi dans ton gant? » – « Voici toute l’histoire. » Et il lui raconta comment on lui avait gâté et ruiné ses clos, et comment les souris avaient envahi le dernier en sa présence.
« Une d’entre elles, » ajouta-t-il, « était très lourde : c’est celle que j’ai attrapée et qui est dans le gant. Je la pendrai demain, et, j’en prends Dieu à témoin, je les pendrais toutes, si je les tenais. »
« Seigneur, je le comprends. Mais ce n’est pas beau de voir un homme aussi élevé, d’aussi haute noblesse que toi, pendre un vil animal comme celui-là. Tu ferais bien de ne pas y toucher et de le laisser aller. »
« Honte à moi, si je ne les pendais pas toutes, si je les tenais. Je pendrai toujours celle que j’ai prise. »
« Seigneur, je n’ai aucune raison de venir en aide à cet animal; je voulais seulement t’éviter une action peu noble. Fais ta volonté, seigneur. »
« Si je savais que tu eusses le moindre sujet de lui venir en aide, princesse, je suivrais ton conseil, mais, comme je n’en vois pas, je suis décidé à le tuer. »
« Volontiers, fais-le. »
Il se rendit à Gorsedd Arberth avec la souris et planta deux fourches à l’endroit le plus élevé du tertre.
A ce moment, il vit venir de son côté un clerc revêtu de vieux habits de peu de valeur, pauvres. Il y avait sept ans que Manawyddan n’avait vu ni homme ni bête, à l’exception des personnes avec lesquelles il avait vécu, lui quatrième, jusqu’au moment où deux d’entre elles encore avaient disparu.
« Seigneur, » dit le clerc, « bonjour à toi. »
« Dieu te donne bien, » répondit-il, « sois le bienvenu. D’où viens-tu, clerc? »
« Je viens de Lloegyr, où j’ai été chanter. Pourquoi me le demandes-tu? »
« Parce que, depuis sept ans, je n’ai vu que quatre personnes isolées, et toi en ce moment. »
« Eh bien, Seigneur, moi je me rends maintenant, à travers cette contrée, dans mon propre pays. A quoi es-tu donc occupé, seigneur? »
« A pendre un voleur que j’ai surpris me volant. »
« Quelle espèce de voleur? Je vois dans ta main quelque chose comme une souris. Il n’est guère convenable, pour homme de ton rang, de manier un pareil animal; lâche-le. »
« Je ne le lâcherai point, par moi et Dieu. Je l’ai surpris en train de me voler ; je lui appliquerai la loi des voleurs : je le pendrai. »
« Seigneur, plutôt que de voir un homme de ton rang accomplir pareille besogne, je te donnerai une livre que j’ai recueillie en mendiant; donne la liberté à cet animal. »
« Je n’en ferai rien, et je ne le vendrai pas. »
« Comme tu voudras, seigneur; si ce n’était pour ne pas voir un homme de ton rang manier un pareil animal, cela me serait indifférent. » Et le clerc s’éloigna.
Au moment où il mettait la traverse sur les fourches, il vit venir à lui un prêtre monté sur un cheval harnaché.
« Seigneur, » dit le prêtre, « bonjour à toi. »
« Dieu te donne bien, » répondit Manawyddan : « ta bénédiction? »
« Dieu te bénisse. Et que fais-tu là, seigneur? » – « Je pends un voleur que j’ai pris en train de me voler. »
« Quelle espèce de voleur est celui-là, seigneur? »
« C’est un animal, une espèce de souris; il m’a volé; il aura la mort des voleurs. »
« Seigneur, plutôt que te voir manier pareil animal, je te l’achète; lâche-le. » – « J’en atteste Dieu : je ne le vendrai ni ne le lâcherai. »
« Il est juste de reconnaître, seigneur, qu’il n’a aucune valeur. Mais, pour ne pas te voir te salir au contact de cette bête, je te donnerai trois livres; lâche-le. »
« Je ne veux, par moi et Dieu, pour lui aucune compensation autre que celle à laquelle il a droit : la pendaison. »
« C’est bien, seigneur, fais à ta tête. » Le prêtre prit le large.
Manawyddan enroula la ficelle autour du cou de la souris. Comme il se mettait à l’élever en l’air, il aperçu un train d’évêque avec ses bagages et sa suite. L’évêque se dirigeait vers lui. Il s’arrêta dans son œuvre.
« Seigneur évêque, » dit-il, « ta bénédiction? »
« Dieu te donne sa bénédiction, » répondit-il.
« Que fais-tu donc là? »
« Je pends un voleur que j’ai pris en train de me voler. »
« N’est-ce pas une souris que je vois dans ta main? »
« Oui, et elle m’a volé. »
« Puisque je surviens au moment où elle va périr, je te l’achète; je te donnerai pour elle sept livres. Je ne veux pas voir un homme de ton rang détruire un animal aussi insignifiant que celui-là; lâche-le donc, et la somme est à toi. »
« Je ne le lâcherai pas, par moi et Dieu. »
« Puisque tu ne veux pas le relâcher à ce prix, je t’offre vingt-quatre livres d’argent comptant. »
« Je ne le lâcherais pas, j’en prends Dieu à témoin, pour le double. »
« Puisque tu ne veux pas le lâcher à ce prix, je te donne tout ce que tu vois de chevaux dans ce champ, les sept charges et les sept chevaux qui les traînent. »
« Je refuse, par moi et Dieu. »
« Puisque tu n’en veux pas, fais ton prix toi-même. »
« Je veux la liberté de Riannon et Pryderi. »
« Tu l’auras. »
« Ce n’est pas assez, par moi et Dieu. »
« Que veux-tu donc? »
« Que tu fasses disparaître le charme et l’enchantement de dessus les sept cantrevs. »
« Je te l’accorde; relâche la souris. »
« Je ne la lâcherai pas avant d’avoir su qui elle est. »
« C’est ma femme, et si cela n’était, je n’essaierais pas de la faire relâcher.»
« Pour quoi est-elle venue à moi? »
« Pour piller. Je suis Llwyt, fils de Kilcoet. C’est moi qui ai jeté le charme sur les sept cantrevs de Dyvet, et cela par amitié pour Gwawl, fils de Clut, et qui ai puni sur Pryderi le jeu du Blaireau dans le sac que Pwyll, chef d’Annwn, avait fait subir à Gwawl dans la cour d’Eveydd Hen, par une mauvaise inspiration. Ayant appris que tu étais venu habiter le pays, les gens de ma famille vinrent me trouver, et me demandèrent de les changer en souris pour détruire ton blé. La première nuit, il n’y eut que mes gens à y aller; la deuxième nuit, de même, et ils détruisirent les deux clos. La troisième nuit, ma femme et les dames de la cour me prièrent de les métamorphoser aussi. Je le fis. Elle était enceinte; sans cela tu ne l’aurais pas atteinte. Puisqu’il en est ainsi, et que tu la tiens, je te rendrai Pryderi et Riannon; je débarrasserai Dyvet du charme et de l’enchantement. Je t’ai révélé qui elle était; lâche-la maintenant. »
« Je ne le ferai point, par moi et Dieu. »
« Que veux-tu donc? »
« Voici ce que je veux : qu’il n’y ait jamais d’enchantement, et qu’on ne puisse jeter de charme sur Dyvet. »
« Je l’accorde; lâche-la. »
« Je n’en ferai rien par ma foi. »
« Que veux-tu donc encore? »
« Qu’on ne tire jamais vengeance de ceci sur Pryderi, Riannon et moi. »
« Tout cela, tu l’auras, et tu as été vraiment bien inspiré; sans cela, tous les malheurs retombaient sur toi. »
« Oui, et c’est pour l’éviter que j’ai ainsi précisé. »
« Mets ma femme en liberté maintenant. »
« Je ne la délivrerai pas, par moi et Dieu, avant d’avoir vu Pryderi et Riannon libres ici avec moi. »
« Les voici qui viennent. » A ce moment parurent Pryderi et Riannon. Manawyddan alla à leur rencontre, les salua, et ils s’assirent ensemble.
« Seigneur, » dit l’évêque, « délivre maintenant ma femme; n’as-tu pas eu tout ce que tu as indiqué? »
« Avec plaisir.» Et il la mit en liberté. L’évêque la frappa de sa baguette enchantée, et elle redevint une jeune femme, la plus belle qu’on eût jamais vue.
« Regarde le pays autour de toi, » dit-il, « et tu verras les maisons et les habitations en aussi bon état que jamais. » Il se leva et regarda. Tout le pays était habité, pourvu de ses troupeaux et de toutes ses maisons.
« A quel service ont été occupés Pryderi et Riannon? » dit Manawyddan.
«Pryderi portait au cou les marteaux de la porte de ma cour. Riannon avait au cou, elle, les licous des ânes après qu’ils avaient été porter le foin. Voilà quelle a été leur captivité. «
C’est à cause de cela qu’on a appelé cette histoire le Mabinogi de Mynnweir et de Mynordd. Ainsi se termine cette branche du Mabinogi.