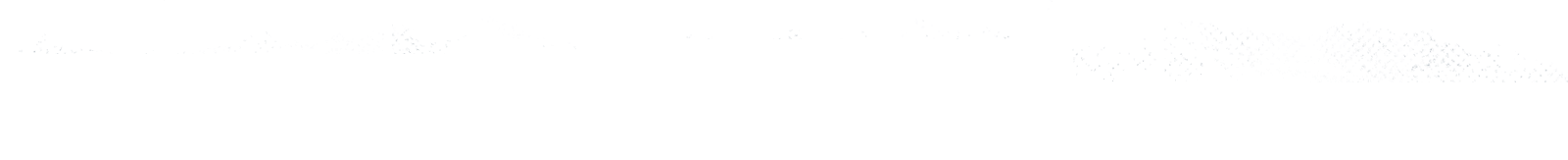Pwyll, prince de Dyvet, régnait sur les sept cantrevs de ce pays. Un jour qu’il était à Arberth, sa principale cour, il lui prit fantaisie d’aller à la chasse. L’endroit de ses domaines qu’il avait en vue pour la chasse, c’était Glynn Cuch. Il partit la nuit même d’Arberth et arriva à Llwyn Diarwya où il passa la nuit. Le lendemain il se leva, dans la jeunesse du jour, et se rendit à Glynn Cuch pour y lancer ses chiens sous bois. Son cor sonna le rassemblement pour la chasse; il s’élança à la suite des chiens et perdit bientôt ses compagnons.
Pwyll, prince de Dyvet, régnait sur les sept cantrevs de ce pays. Un jour qu’il était à Arberth, sa principale cour, il lui prit fantaisie d’aller à la chasse. L’endroit de ses domaines qu’il avait en vue pour la chasse, c’était Glynn Cuch. Il partit la nuit même d’Arberth et arriva à Llwyn Diarwya où il passa la nuit. Le lendemain il se leva, dans la jeunesse du jour, et se rendit à Glynn Cuch pour y lancer ses chiens sous bois. Son cor sonna le rassemblement pour la chasse; il s’élança à la suite des chiens et perdit bientôt ses compagnons.
Comme il prêtait l’oreille aux aboiements des chiens, il entendit ceux d’une autre meute; la voix n’était pas la même et cette meute s’avançait à la rencontre de la sienne. A ce moment, une clairière unie s’offrit à sa vue dans le bois, et, au moment où sa meute apparaissait sur la lisière de la clairière, il aperçut un cerf fuyant devant l’autre. Il arrivait au milieu de la clairière lorsque la meute qui le poursuivait l’atteignit et le terrassa. Pwyll se mit à considérer la couleur de ces chiens sans plus songer au cerf : jamais il n’en avait vu de pareille à aucun chien de chasse au monde. Ils étaient d’un blanc éclatant et lustré, et ils avaient les oreilles rouges, d’un rouge aussi luisant que leur blancheur. Pwyll s’avança vers les chiens, chassa la meute qui avait tué le cerf et appela ses chiens à la curée.
A ce moment il vit venir à la suite de la meute, un chevalier monté sur un grand cheval gris fer, un cor de chasse passé autour du cou, portant un habit de chasse de laine grise.
Le chevalier s’avança vers lui et lui parla ainsi :
« Prince, je sais qui tu es, et je ne te saluerai point.»
« C’est que tu es peut-être,» répondit Pwyll, « d’un rang tel que tu puisses t’en dispenser.»
« Ce n’est pas assurément l’éminence de mon rang qui m’en empêche.»
« Quoi donc, seigneur ?»
« Par moi et Dieu, ton impolitesse et ton manque de courtoisie.»
« Quelle impolitesse, seigneur, as-tu remarquée en moi ?»
« Je n’ai jamais vu personne en commettre une plus grande que de chasser une meute qui a tué un cerf et d’appeler la sienne à la curée ! c’est bien là un manque de courtoisie; et, quand même je ne me vengerais pas de toi, par moi et Dieu, je te ferai mauvaise réputation pour la valeur de plus de cent cerfs.»
« Si je t’ai fait tort, je rachèterai ton amitié.»
« De quelle manière ?»
« Ce sera selon ta dignité; je ne sais qui tu es.»
« Je suis couronné dans mon pays d’origine.»
« Seigneur, bon jour à toi ! Et de quel pays es-tu ? »
« D’Annwvyn; je suis Arawn, roi d’Annwvyn.»
« De quelle façon, seigneur, obtiendrai-je ton amitié ?»
« Voici : il y a quelqu’un dont les domaines sont juste en face des miens et qui me fait continuellement la guerre; c’est Havgan roi d’Annwvyn. Si tu me débarrasses de ce fléau, et tu le pourras facilement, tu obtiendras sans peine mon amitié.»
« Je le ferai volontiers. Indique-moi comment j’y arriverai.»
« Voici comment. Je vais lier avec toi confraternité intime; je te mettrai à ma place à Annwvyn; je te donnerai pour dormir avec toi chaque nuit la femme la plus belle que tu aies jamais vue. Tu auras ma figure et mon aspect, si bien qu’il n’y aura ni valet de la chambre, ni officier, ni personne parmi ceux qui m’ont jamais suivi, qui se doute que ce n’est pas moi. Et cela, jusqu’à la fin de cette année, à partir de demain. Notre entrevue aura lieu alors dans cet endroit-ci. »
« Bien, mais, même après avoir passé un an là-bas, d’après quelles indications pourrai-je me rencontrer avec l’homme que tu dis? »
« La rencontre entre lui et moi est fixée à un an ce soir, sur le gué; sois-y sous mes traits; donne-lui un seul coup, et il ne survivra pas. Il t’en demandera un second, mais ne le donne pas en dépit de ses supplications. Moi, j’avais beau frapper, le lendemain il se battait avec moi de plus belle. »
« Bien, mais que ferai-je pour mes états ? »
« Je pourvoirai, » dit Arawn, « à ce qu’il n’y ait dans tes états ni homme ni femme qui puisse soupçonner que c’est moi qui aurai pris tes traits; j’irai à ta place. »
« Volontiers, je pars donc. »
« Ton voyage se fera sans difficulté; rien ne te fera obstacle jusqu’à ce que tu arrives dans mes Etats : je serai ton guide. » Il conduisit Pwyll jusqu’en vue de la cour et des habitations.
« Je remets, » dit-il, « entre tes mains ma cour et mes domaines. Entre, il n’y a personne qui hésite à te reconnaître. A la façon dont tu verras le service se faire, tu apprendras les manières de la cour. »
Pwyll se rendit à la cour. Il y aperçut des chambres à coucher, des salles, des appartements avec les décorations les plus belles qu’on pût voir dans une maison. Aussitôt qu’il entra dans la salle, des écuyers et de jeunes valets accoururent pour le désarmer. Chacun d’eux le saluait en arrivant. Deux chevaliers vinrent le débarrasser de son habit de chasse et le revêtir d’un habit d’or de paile. La salle fut préparée; il vit entrer la famille, la suite, la troupe la plus belle et la mieux équipée qui se fût jamais vue, et avec eux la reine, la plus belle femme du monde, vêtue d’un habit d’or de paile lustrée.
Après s’être lavés, ils se mirent à table : la reine d’un côté de Pwyll, le comte, à ce qu’il supposait, de l’autre. Il commença à causer avec la reine et il jugea, à sa conversation, que c’était bien la femme la plus avisée, au caractère et au langage le plus nobles, qu’il eût jamais vue. Ils eurent à souhaits mets, boissons, musique, compotation; c’était bien de toutes les cours qu’il avait vues au monde, la mieux pourvue de nourriture, de boissons, de vaisselle d’or et de bijoux royaux.
Lorsque le moment du sommeil fut arrivé, la reine et lui allèrent se coucher. Aussitôt qu’ils furent au lit, il lui tourna le dos et resta le visage fixé vers le bord du lit, sans lui dire un seul mot jusqu’au matin. Le lendemain, il n’y eut entre eux que gaieté et aimable conversation. Mais, quelle que fût leur affection pendant le jour, il ne se comporta pas une seule nuit jusqu’à la fin de l’année autrement que la première.
Il passa le temps en chasses, chants, festins, relations aimables, conversations avec ses compagnons, jusqu’à la nuit fixée pour la rencontre. Cette rencontre, il n’y avait pas un homme, même dans les parages les plus éloignés du royaume, qui ne l’eût présente à l’esprit. Il s’y rendit avec les gentilshommes de ses domaines.
Aussitôt son arrivée, un chevalier se leva et parla ainsi :
« Nobles, écoutez-moi bien : c’est entre les deux rois qu’est cette rencontre, entre leurs deux corps seulement. Chacun d’eux réclame à l’autre terre et domaines. Vous pouvez tous rester tranquilles, à la condition de laisser l’affaire se régler entre eux deux. »
Aussitôt les deux rois s’approchèrent l’un de l’autre vers le milieu du gué, et en vinrent aux mains. Au premier choc, le remplaçant d’Arawn atteignit Havgan au milieu de la boucle de l’écu si bien qu’il le fendit en deux, brisa l’armure et lança Havgan à terre, de toute la longueur de son bras et de sa lance, par-dessus la croupe de son cheval mortellement blessé.
« Ah, prince, » s’écria Havgan, « quel droit avais-tu à ma mort? Je ne te réclamais rien; tu n’avais pas de motifs, à ma connaissance, pour me tuer. Au nom de Dieu, puisque tu as commencé, achève-moi. »
« Prince, » répondit-il, « il se peut que je me repente de ce que je t’ai fait; cherche qui te tue, pour moi, je ne te tuerai pas. »
« Mes nobles fidèles, emportez-moi d’ici; c’en est fait de moi; je ne suis plus en état d’assurer plus longtemps votre sort. »
« Mes nobles, » dit le remplaçant d’Arawn, « faites-vous renseigner et sachez quels doivent être mes vassaux. »
« Seigneur, » répondirent les nobles, « tous ici doivent l’être; il n’y a plus d’autre roi sur tout Annwvyn que toi. »
« Eh bien, il est juste d’accueillir ceux qui se montreront sujets soumis; pour ceux qui ne viendront pas faire leur soumission, qu’on les y oblige par la force des armes. »
Il reçut aussitôt l’hommage des vassaux, et commença à prendre possession du pays; vers le milieu du jour, le lendemain; les deux royaumes étaient en son pouvoir. Il partit ensuite pour le lieu du rendez-vous, et se rendit à Glynn Cuch. Il y trouva Arawn qui l’attendait; chacun d’eux fit à l’autre joyeux accueil :
« Dieu te récompense », dit Arawn, « tu t’es conduit en camarade, je l’ai appris. Quand tu seras de retour, dans ton pays », ajouta-t-il, « tu verras ce que j’ai fait pour toi. »
«Dieu te le rende », répondit Pwyll.
Arawn rendit alors sa forme et ses traits à Pwyll, prince de Dyvet et, reprit les siens; puis il retourna à sa cour en Annwvyn.
Il fut heureux de se retrouver avec ses gens et sa famille, qu’il n’avait pas vus depuis un longtemps. Pour eux, ils n’avaient pas senti son absence, et son arrivée ne parut pas, cette fois, plus extraordinaire que de coutume. Il passa la journée dans la gaieté, la joie, le repos et les conversations avec sa femme et ses nobles.
Quand le moment leur parut venu de dormir plutôt que de boire, ils allèrent se coucher. Le roi se mit au lit et sa femme alla le rejoindre.
Après quelques moments d’entretien, il se livra avec elle aux plaisirs de l’amour. Comme elle n’y était plus habituée depuis un an, elle se mit à réfléchir.
« Dieu », dit-elle, « comment se fait-il qu’il ait eu cette nuit des sentiments autres que toutes les autres nuits depuis un an maintenant ? »
Elle resta longtemps songeuse. Sur ces entrefaites, il se réveilla. Il lui adressa une première fois la parole, puis une seconde, puis une troisième, sans obtenir une réponse.
« Pourquoi », dit-il, ne me réponds-tu pas ? »
« Je t’en dirai, » répondit-elle, « plus que je n’en ai dit en pareil lieu depuis un an. »
« Comment ? Nous nous sommes entretenus de bien des choses. »
« Honte à moi, si, il y aura eu un an hier soir, à partir de l’instant où nous nous trouvions dans les plis de ces draps de lit, il y a eu entre nous jeux et entretiens; si tu as même tourné ton visage vers moi, sans parler, à plus forte raison, de choses plus importantes ! »
Lui aussi devint songeur. « En vérité, Seigneur Dieu », s’écria-t-il, « il n’y a pas d’amitié plus solide et plus constante que celle du compagnon que j’ai trouvé ». Puis il dit à sa femme:
« Princesse, ne m’accuse pas; par moi et Dieu, je n’ai pas dormi avec toi, je ne me suis pas étendu à tes côtés depuis un an hier au soir. »
Et il lui raconta son aventure.
« J’en atteste Dieu, » dit-elle, « tu as mis la main sur un ami solide et dans les combats, et dans les épreuves du corps, et dans la fidélité qu’il t’a gardée. »
« Princesse, c’était justement à quoi je réfléchissais, lorsque je me suis tu vis-à-vis de toi. »
« Ce n’était donc pas étonnant », répondit-elle.
Pwyll, prince de Dyvet, retourna aussi dans ses domaines et son pays. Il commença par demander à ses nobles ce qu’ils pensaient de son gouvernement, cette année-là, en comparaison des autres années.
« Seigneur, » répondirent-ils, « jamais tu n’as montré autant de courtoisie, jamais tu n’as été plus aimable; jamais tu n’as dépensé avec tant de facilité ton bien; jamais ton administration n’a été meilleure que cette année. »
« Par moi et Dieu, » s’écria-t-il, « il est vraiment juste que vous en témoigniez votre reconnaissance à l’homme que vous avez eu au milieu de vous. Voici l’aventure telle qu’elle s’est passée. » Et il la leur raconta tout au long.
« En vérité, seigneur, » dirent-ils, « Dieu soit béni de t’avoir procuré pareille amitié. Le gouvernement que nous avons eu cette année, tu ne nous le reprendras pas? »
« Non , par moi et Dieu, autant qu’il sera en mon pouvoir. »
A partir de ce moment, ils s’appliquèrent à consolider leur amitié; ils s’envoyèrent chevaux, chiens de chasse, faucons, tous les objets précieux que chacun d’eux croyait propres à faire plaisir à l’autre. A la suite de son séjour en Annwvyn, comme il avait gouverné avec tant de succès et réuni en un les deux royaumes le même jour, la qualification de prince de Dyvet pour Pwyll fut laissée de côté, et on ne l’appela plus désormais que Pwyll, chef d’Annwvyn.
Un jour il se trouvait à Arberth, sa principale cour, où un festin avait été préparé, avec une grande suite de vassaux. Après le premier repas, Pwyll se leva, alla se promener, et se dirigea vers le sommet d’un tertre plus haut que la cour, et qu’on appelait Gorsedd Arberth.
« Seigneur, » lui dit quelqu’un de la cour, « le privilège de ce tertre, c’est que tout noble qui s’y assoit, ne s’en aille pas sans avoir reçu des coups et des blessures, ou avoir vu un prodige. »
« Les coups et les blessures, » répondit-il, « je ne les crains pas au milieu d’une pareille troupe.
Quant au prodige, je ne serais pas fâché de le voir. Je vais m’asseoir sur le tertre. »
C’est ce qu’il fit. Comme ils étaient assis, ils virent venir, le long de la grand’route qui partait du tertre, une femme montée sur un cheval blanc-pâle, gros, très grand; elle portait un habit doré et lustré. Le cheval paraissait à tous les spectateurs s’avancer d’un pas lent et égal. Il arriva à la hauteur du tertre.
« Hommes, » dit Pwyll, « y a-t-il parmi vous quelqu’un qui connaisse cette femme à cheval, là-bas? »
« Personne, seigneur, » répondirent-ils.
« Que quelqu’un aille à sa rencontre sur la route , pour savoir qui elle est. »
Un d’eux se leva avec empressement et se porta à sa rencontre; mais quand il arriva devant elle sur la route, elle le dépassa. Il se mit à la poursuivre de son pas le plus rapide; mais plus il se hâtait, plus elle se trouvait loin de lui.
Voyant qu’il ne lui servait pas de la poursuivre, il retourna auprès de Pwyll, et lui dit :
« Seigneur, il est inutile à n’importe quel homme à pied, au monde, de la poursuivre. »
« Eh bien, » répondit Pwyll, « va à la cour, prends le cheval le plus rapide que tu y verras, et pars à sa suite. »
Le valet alla chercher le cheval, et partit.
Arrivé sur un terrain uni, il fit sentir les éperons au cheval; mais plus il le frappait, plus elle se trouvait loin de lui, et cependant son cheval paraissait avoir gardé la même allure qu’elle lui avait donnée au début. Son cheval à lui faiblit.
Quand il vit que le pied lui manquait, il retourna auprès de Pwyll.
« Seigneur, » dit-il, « il est inutile à qui que ce soit de poursuivre cette dame. Je ne connaissais pas auparavant de cheval plus rapide que celui-ci dans tout le royaume, et cependant il ne m’a servi de rien de la poursuivre. »
« Assurément, » dit Pwyll, « il y a là-dessous quelque histoire de sorcellerie. Retournons à la cour. » Ils y allèrent et y passèrent la journée.
Le lendemain, ils y restèrent depuis leur lever jusqu’au moment de manger. Le premier repas terminé, Pwyll dit :
« Nous allons nous rendre au haut du tertre, nous tous qui y avons été hier. Et toi, » dit-il à un écuyer, « amène le cheval le plus rapide que tu connaisses dans les champs. »
Le page obéit; ils allèrent au tertre avec le cheval. Ils y étaient à peine assis qu’ils virent la femme sur le même cheval, avec le même habit, suivant la même route.
« Voici, » dit Pwyll, « la cavalière d’hier. Sois prêt, valet, pour aller savoir qui elle est. »
« Volontiers, seigneur. »
L’écuyer monta à cheval, mais avant qu’il ne fût bien installé en selle, elle avait passé à côté de lui en lui laissant entre eux une certaine distance; elle ne semblait pas se presser plus que le jour précédent. Il mit son cheval au trot, pensant que, quelque tranquille que fût son allure, il l’atteindrait. Comme cela ne lui réussissait pas, il lança son cheval à toute bride; mais il ne gagna pas plus de terrain que s’il eût été au pas. Plus il frappait le cheval, plus elle se trouvait loin de lui, et cependant elle ne semblait pas aller d’une allure plus rapide qu’auparavant. Voyant que sa poursuite était sans résultat, il retourna auprès de Pwyll.
« Seigneur, le cheval ne peut pas faire plus que ce que tu lui as vu faire. »
« Je vois, » répondit-il, « qu’il ne sert à personne de la poursuivre. Par moi et Dieu, elle doit avoir une mission pour quelqu’un de cette plaine; mais elle ne se donne pas le temps de l’exposer. Retournons à la cour. »
Ils y allèrent et y passèrent la nuit, ayant à souhait musique et boissons.
Le lendemain, ils passèrent le temps en divertissements jusqu’au moment du repas. Le repas terminé, Pwyll dit : « Où est la troupe avec laquelle j’ai été, hier et avant hier, au haut du tertre ? »
« Nous voici, Seigneur, » répondirent-ils.
« Allons nous y asseoir. »
« Et toi, » dit-il à son écuyer, « selle bien mon cheval, va vite avec lui sur la route, et apporte mes éperons.» Le serviteur le fit. Ils se rendirent au tertre. Ils y étaient à peine depuis un moment, qu’ils virent la cavalière venir par la même route, dans le même attirail, et s’avançant de la même allure.
« Valet, » dit Pwyll, « je vois venir la cavalière; donne-moi mon cheval. » Il n’était pas plutôt en selle qu’elle l’avait déjà dépassé. Il tourna bride après elle, et lâcha les rênes à son cheval impétueux et fougueux, persuadé qu’il allait l’atteindre au deuxième ou au troisième bond. Il ne se trouva pas plus près d’elle qu’auparavant. Il lança son cheval de toute sa vitesse. Voyant qu’il ne lui servait pas de la poursuivre, Pwyll s’écria « Jeune fille, pour l’amour de l’homme que tu aimes le plus, attends-moi. »
« Volontiers, » dit-elle; « il eût mieux valu pour le cheval que tu eusses fait cette demande il y a déjà quelques temps. »
La jeune fille s’arrêtât et attendit. Elle rejeta la partie de son voile qui lui couvrait le visage, fixa ses regards sur lui et commença à s’entretenir avec lui.
« Princesse, » dit Pwyll, « d’où viens-tu et pourquoi voyages-tu ? »
«Pour mes propres affaires, » répondit-elle, « et je suis heureuse de te voir. »
« Sois la bienvenue. » Aux yeux de Pwyll, le visage de toutes les pucelles ou femmes qu’il avait vues n’était d’aucun charme à côté du sien.
« Princesse, » ajouta-t-il, « me diras-tu un mot de tes affaires? »
« Oui, par moi et Dieu, » répondit-elle, « ma principale affaire était de chercher à te voir ».
« Voilà bien, pour moi, la meilleure affaire pour laquelle tu puisses venir. Me diras-tu qui tu es ? »
« Prince, je suis Riannon, fille de Heveidd Hen. On veut me donner à quelqu’un malgré moi. Je n’ai voulu d’aucun homme, et cela par amour pour toi, et je ne voudrai jamais de personne, à moins que tu ne me repousses. C’est pour avoir ta réponse à ce sujet que je suis venue. »
« Par moi et Dieu, la voici : Si on me donnait à choisir entre toutes les femmes et les pucelles du monde, c’est toi que je choisirais. »
« Eh bien ! si telle est ta volonté, fixe-moi un rendez-vous avant qu’on ne me donne à un autre. »
« Le plus tôt sera le mieux; fixe-le à l’endroit que tu voudras. »
« Eh bien, seigneur, dans un an, ce soir, un festin sera préparé par mes soins, en vue de ton arrivée, dans la cour d’Heveidd. »
« Volontiers, j’y serai au jour dit. »
« Reste en bonne santé, seigneur, et souviens-toi de ta promesse. Je m’en vais. »
Ils se séparèrent, Pwyll revint auprès de ses gens et de la suite. Quelque demande qu’on lui fit au sujet de la jeune fille, il passait à d’autres sujets.
Ils passèrent l’année à Arberth jusqu’au moment fixé. Il s’équipa avec ses chevaliers, lui centième, et se rendit à la cour d’Eveidd Hen. On lui fit bon accueil. Il y eut grande réunion, grande joie et grands préparatifs de festin à son intention. On disposa de toutes les ressources de la cour d’après sa volonté.
La salle fut préparée et on se mit à table Heveidd Hen s’assit à un des côtés de Pwyll, Riannon de l’autre; et, après eux, chacun suivant sa dignité. On se mit à manger, à boire et à causer.
Après avoir fini de manger, au moment où on commençait à boire, on vit entrer un grand jeune homme brun, à l’air princier, vêtu de paile. De l’entrée de la salle, il adressa son salut à Pwyll et à ses compagnons.
« Dieu te bénisse, mon âme, » dit Pwyll, « viens t’asseoir. »
« Non, » répondit-il, « je suis un solliciteur et je vais exposer ma requête. »
« Volontiers. »
« Seigneur, c’est à toi que j’ai affaire et c’est pour te faire une demande que je suis venu. »
« Quel qu’en soit l’objet, si je puis te le faire tenir, tu l’auras. »
« Hélas ! » dit Riannon, « pourquoi fais-tu une pareille réponse ? »
« Il l’a bien faite, princesse, » dit l’étranger, « en présence de ces gentilshommes»
« Quelle est ta demande, mon âme? » dit Pwyll.
« Tu dois coucher cette nuit avec la femme que j’aime le plus; c’est pour te la réclamer, ainsi que les préparatifs et approvisionnements du festin, que je suis venu ici. » Pwyll resta silencieux, ne trouvant rien à répondre.
« Tais-toi tant que tu voudras, » s’écria Riannon; « je n’ai jamais vu d’homme faire preuve de plus de lenteur d’esprit que toi. »
« Princesse, » répondit-il, « je ne savais pas qui il était. »
« C’est l’homme à qui on a voulu me donner malgré moi, Gwawl, fils de Clut, personnage belliqueux et riche. Mais puisqu’il t’est échappé de parler comme tu l’as fait, donne-moi à lui pour t’éviter une honte. »
« Princesse, je ne sais quelle réponse est la tienne; je ne pourrai jamais prendre sur moi de dire ce que tu me conseilles.»
« Donne-moi à lui et je ferai qu’il ne m’aura jamais.»
« Comment cela ? »
« Je te mettrai en main un petit sac; garde-le bien. Il te réclamera le festin et tous ses préparatifs et approvisionnements, mais rien de cela ne t’appartient. Je le distribuerai aux troupes et à la famille. Tu lui répondras dans ce sens. Pour ce qui me concerne, je lui fixerai un délai d’un an, à partir de ce soir, pour coucher avec moi.
Au bout de l’année, trouve-toi avec ton sac, avec tes chevaliers, toi centième, dans le verger là haut. Lorsqu’il sera en plein amusement et compotation, entre, vêtu d’habits de mendiant, le sac en main, et ne demande que plein le sac de nourriture. Quand même on y fourrerait tout ce qu’il y a de nourriture et de boisson dans ces sept cantrevs-ci, je ferai qu’il ne soit pas plus plein qu’auparavant.
Quand on y aura fourré une grande quantité, il te demandera si ton sac ne sera jamais plein. Tu lui répondras qu’il ne le sera point, si un noble très puissant ne se lève, ne presse avec ses pieds la nourriture dans le sac et ne dise : « on en a assez mis. » C’est lui que j’y ferai aller pour fouler la nourriture. Une fois qu’il y sera entré, tourne le sac jusqu’à ce qu’il en ait pardessus la tête et fais un noeud avec les courroies du sac. Aie une bonne trompe autour du cou, et, aussitôt que le sac sera lié sur lui, sonne de la trompe : ce sera le signal convenu entre toi et tes chevaliers. A ce son, qu’ils fondent sur la cour. »
Gwawl dit à Pwyll : « Il est temps que j’aie réponse au sujet de ma demande. »
« Tout ce que tu m’as demandé de ce qui est en ma possession, » répondit-il, « tu l’auras ».
« Mon âme, » lui dit Riannon, « pour le festin avec tous les approvisionnements, j’en ai disposé en faveur des hommes de Dyvet, de ma famille et des compagnies qui sont ici; je ne permettrai de le donner à personne. Dans un an ce soir, un festin se trouvera préparé dans cette salle pour toi, mon âme, pour la nuit où tu coucheras avec moi. » Gwawl retourna dans ses terres, Pwyll en Dyvet, et ils y passèrent l’année jusqu’au moment fixé pour le festin dans la cour d’Eveidd Hen.
Gwawl, fils de Clut, se rendit au festin préparé pour lui; il entra dans la cour et il reçut bon accueil. Quand à Pwyll, chef d’Annwvyn, il se rendit au verger avec ses chevaliers, lui centième, comme lui avait recommandé Riannon, muni de son sac. Il revêtit de lourds haillons et mit de grosses chaussures. Lorsqu’il sut qu’on avait fini de manger et qu’on commençait à boire, il marcha droit à la salle.
Arrivé à l’entrée, il salua Gwawl et ses compagnons, hommes et femmes. « Dieu te donne bien. » dit Gwawl,« sois le bienvenu en son nom. »
« Seigneur, » répondit-il, « j’ai une requête à te faire. »
« Qu’elle soit la bienvenue; si tu me fais une demande convenable, tu l’obtiendras. »
« Convenable, seigneur; je ne demande que par besoin. Voici ce que je demande plein le petit sac que tu vois de nourriture. »
« Voilà bien une demande modeste; je te l’accorde volontiers apportez-lui de la nourriture.»
Un grand nombre d’officiers se levèrent et commencèrent à remplir le sac. On avait beau en mettre : il n’était pas plus plein qu’en commençant.
« Mon âme, » dit Gwawl, « ton sac sera-t-il jamais plein? »
« Il ne le sera jamais, par moi et Dieu, quoi que l’on y mette, à moins qu’un maître de terres, de domaines et de vassaux ne se lève, ne presse la nourriture avec ses deux pieds dans le sac et ne dise : « On en a mis assez. »
« Champion, » dit Riannon à Gwawl, fis de Clut, « lève-toi vite ».
« Volontiers, » répondit-il. Il se leva et mit ses deux pieds dans le sac. Pwyll tourna le sac si bien que Gwawl en eut par dessus la tête et, rapidement, il ferma le sac, le noua avec les courroies, et sonna du cor. Les gens de sa maison envahirent la cour, saisirent tous ceux qui étaient venus avec Gwawl et l’exposèrent lui-même dans sa propre prison (le sac).
Pwyll rejeta les haillons, les grosses chaussures et toute sa grossière défroque. Chacun de ses gens en entrant donnait un coup sur le sac en disant : « Qu’y a-t-il là-dedans ? »
« Un blaireau, » répondaient les autres. Le jeu consistait à donner un coup sur le sac, soit avec le pied, soit avec une trique. Ainsi firent-ils le jeu du sac. Chacun en entrant demandait « Quel jeu faites-vous là? »
«Le jeu du blaireau dans le sac», répondaient-ils.
Et c’est ainsi que se fit pour la première fois le jeu du Blaireau dans le sac.
« Seigneur, » dit l’homme du sac à Pwyll, « si tu voulais m’écouter, ce n’est pas un traitement qui soit digne de moi que d’être ainsi battu dans ce sac. »
« Seigneur, » dit aussi Eveydd Hen, « il dit vrai. Ce n’est pas un traitement digne de lui. »
« Eh bien, » répondit Pwyll, « je suivrai ton avis à ce sujet. »
« Voici ce que tu as à faire, » dit Riannon, « tu es dans une situation qui te commande de satisfaire les solliciteurs et les artistes. Laisse-le donner à chacun à ta place et prends des gages de lui qu’il n’y aura jamais ni réclamation, ni vengeance à son sujet. Il est assez puni. »
« J’y consens volontiers, » dit l’homme du sac.
« J’accepterai, » dit Pwyll « si c’est l’avis d’Eveidd et de Riannon. »
« C’est notre avis, » répondirent-ils.
« J’accepte donc : cherchez des cautions pour lui.»
« Nous le serons, nous » répondit Eveydd, «jusqu’à ce que ses hommes soient libres et répondent pour lui. » Là-dessus, on le laissa sortir du sac et on délivra ses nobles.
« Demande maintenant des cautions à Gwawl, » dit Eveydd à Pwyll, « nous connaissons tous ceux qu’on peut accepter de lui. » Eveydd énuméra les cautions.
« Maintenant, » dit Gwawl à Pwyll, arrange toi même le traité. »
« Je me contente, » répondit-il, « de celui qu’a proposé Riannon. » Cet arrangement fut confirmé par les cautions.
« En vérité, seigneur, » dit alors Gwawl, « je suis moulu et couvert de contusions. J’ai besoin de bains : avec ta permission, je m’en irai et je laisserai des nobles ici à ma place pour répondre à chacun de ceux qui viendront vers toi en solliciteurs.»
« Je le permets volontiers, » répondit Pwyll. Gwawl retourna dans ses terres.
On prépara la salle pour Pwyll, ses gens et ceux de la cour en outre. Puis tous se mirent à table et chacun s’assit dans le même ordre qu’il y avait un an pour ce soir-là. Ils mangèrent et burent. Quand le moment fut venu, Pwyll et Riannon se rendirent à leur chambre. La nuit se passa dans les plaisirs et le contentement.
Le lendemain, dans la jeunesse du jour, Riannon dit : « Seigneur, lève-toi, et commence à satisfaire les artistes; ne refuse aujourd’hui à personne ce qu’il te demandera. »
« Je le ferai volontiers, » dit Pwyll, « et aujourd’hui et les jours suivants, tant que durera ce banquet. »
Pwyll se leva et fit faire une publication invitant les solliciteurs et les artistes à se montrer et leur signifiant qu’on satisferait chacun d’eux suivant sa volonté et sa fantaisie. Ce qui fut fait. Le banquet se continua et, tant qu’il dura, personne n’éprouva de refus. Quand il fut terminé, Pwyll dit à Eveydd, « Seigneur, avec ta permission, je partirai pour Dyvet demain. »
« Eh bien, » répondit Eveydd, « que Dieu aplanisse la voie devant toi. Fixe le terme et le moment où Riannon ira te rejoindre. »
« Par moi et Dieu, » répondit-il, « nous partirons tous les deux ensemble d’ici. »
« C’est bien ton désir, seigneur ? »
« Oui, par moi et Dieu. »
Ils se mirent en marche le lendemain pour Dyvet et se rendirent à la cour d’Arberth, où un festin avait été préparé pour eux. De tout le pays, de toutes les terres, accoururent autour d’eux les hommes et les femmes les plus nobles. Riannon ne laissa personne sans lui faire un présent remarquable, soit collier, soit anneau, soit pierre précieuse.
Ils gouvernèrent le pays d’une façon prospère cette année, puis une seconde. Mais la troisième, les hommes du pays commencèrent à concevoir de sombres pensées, en voyant sans héritier un homme qu’ils aimaient autant qu’ils faisaient leur seigneur et leur frère de lait : ils le prièrent de se rendre auprès d’eux. La réunion eut lieu à Presseleu, en Dyvet.
« Seigneur, » lui dirent-ils, « nous ne savons si tu vivras aussi vieux que certains hommes de ce pays, et nous craignons que tu n’aies pas d’héritier de la femme avec laquelle tu vis. Prends-en donc une autre qui te donne un héritier. Tu ne dureras pas toujours; aussi, quand même tu voudrais rester ainsi, nous ne te le permettrions pas. »
« Il n’y a pas encore longtemps, » répondit Pwyll, « que nous sommes ensemble. Il peut arriver bien des choses. Remettez avec moi cette affaire d’ici à un an. Convenons de, nous réunir aujourd’hui dans un an, et alors je suivrai votre avis. » On convint du délai.
Avant le terme fixé un fils lui naquit, à Arberth même. La nuit de sa naissance, on envoya des femmes veiller la mère et l’enfant. Les femmes s’endormirent, ainsi que Riannon la mère. Ces femmes étaient au nombre de six. Elles veillèrent bien une partie de la nuit; mais, dès avant minuit, elles s’endormirent et ne se réveillèrent qu’au point du jour. Aussitôt réveillées, leurs yeux se dirigèrent vers l’endroit où elles avaient placé l’enfant : il n’y avait plus de trace de lui.
« Hélas ! » s’écria une d’elles, « l’enfant est perdu ! »
« Assurément, » dit une autre, « on trouvera que c’est une trop faible expiation pour nous de la perte de l’enfant que de nous brûler ou de nous tuer ! »
« Y a-t-il au monde, » s’écria une autre, « un conseil à suivre en cette occasion ? »
« Oui, » répondit une d’elles, « j’en sais un bon.»
« Lequel? » dirent-elles toutes.
« Il y a ici une chienne de chasse avec ses petits. Tuons quelques-uns de petits, frottons de leur sang le visage et les mains de Riannon, jetons les os devant elle et jurons que c’est elle qui a tué son fils. Notre serment à nous six l’emportera sur son affirmation à elle seule.
Elles s’arrêtèrent à ce projet.
Vers le jour, Riannon s’éveilla et dit : « Femmes où est mon fils? »
« Princesse, ne nous demande pas ton fils; nous ne sommes que plaies et contusions, après notre lutte contre toi; jamais en vérité, nous n’avons vu autant de force chez une femme; il ne nous a servi de rien de lutter contre toi : tu as toi-même mis en pièces ton fils. Ne nous le réclame donc pas. »
« Malheureuses, » répondit-elle, « par le Seigneur Dieu qui voit tout, ne faites pas peser sur moi une fausse accusation. Dieu qui sait tout, sait que c’est faux. Si vous avez peur, j’en atteste Dieu, je vous protégerai. »
« Assurément, » s’écrièrent-elles, « nous ne nous exposerons pas nous-mêmes à mal pour personne au monde. »
« Malheureuses, mais vous n’aurez aucun mal en disant la vérité. » En dépit de tout ce qu’elle put leur dire de beau et d’attendrissant, elle n’obtint d’elles que la même réponse.
A ce moment, Pwyll se leva, ainsi que sa troupe et toute sa maison. On ne put lui cacher le malheur. La nouvelle s’en répandit par le pays. Tous les nobles l’apprirent; ils se réunirent et envoyèrent des messagers à Pwyll pour lui demander de se séparer de sa femme après un forfait aussi horrible. Pwyll leur fit cette réponse :
« Vous ne m’avez demandé de me séparer de ma femme que pour une seule raison : c’est qu’elle n’avait pas d’enfant. Or, je lui en connais un. Je ne me séparerai donc pas d’elle. Si elle a mal fait, qu’elle en fasse pénitence. »
Riannon fit venir des docteurs et des sages, et lui parut plus digne d’accepter une pénitence que d’entrer en discussion avec les femmes. Voici la pénitence qu’on lui imposa : elle resterait pendant sept ans de suite à la cour d’Arberth, s’assoirait chaque jour à côté du montoir de pierre qui était à l’entrée, à l’extérieur, raconterait à tout venant qui lui paraîtrait l’ignorer toute l’aventure et proposerait, aux hôtes et aux étrangers, s’ils voulaient le lui permettre, de les porter sur son dos à la cour.
II arriva rarement que quelqu’un consentît à se laisser porter. Elle passa ainsi une partie de l’année.
En ce temps-là, il y avait comme seigneur à Gwent Is-coed Teyrnon Twryv Vliant.
C’était le meilleur homme du monde. Il avait chez lui une jument qu’aucun cheval ou jument dans tout le royaume ne surpassait en beauté.
Tous les ans, dans la nuit des calendes de mai, elle mettait bas, mais personne n’avait de nouvelles du poulain. Un soir, Teyrnon dit à sa femme : « Femme, nous sommes vraiment bien nonchalants : nous avons chaque année un poulain de notre jument et nous n’en conservons aucun ! »
« Que peut on y faire? » répondit-elle.
« Que la vengeance de Dieu soit sur moi, si cette nuit, qui est celles des calendes de mai, je ne sais quel genre de destruction m’enlève ainsi mes poulains. » II fit rentrer sa jument, se revêtit de son armure et commença sa garde.
Au commencement de la nuit, la jument mit bas un poulain grand et accompli qui se dressa sur ses pieds immédiatement. Teyrnon se leva et se mit à considérer les belles proportions du cheval.
Pendant qu’il était ainsi occupe, il entendit un grand bruit, et, aussitôt après, il vit une griffe pénétrer par une fenêtre qui était sur la maison et saisir le cheval par la crinière.
Teyrnon tira son épée et trancha le bras à partir de l’articulation du coude, si bien que cette partie et le poulain lui restèrent à l’intérieur. Là-dessus, tumulte et cris perçants se firent entendre. Il ouvrit la porte s’élança dans la direction du bruit.
Il n’en voyait pas l’auteur à cause de l’obscurité, mais il se précipita de son côté et se mit à sa
poursuite.
S’étant souvenu qu’il avait laissé la porte ouverte, il revint. A la porte même, il trouva un petit garçon emmailloté et enveloppé dans un manteau de paile. Il le prit : l’enfant était fort pour l’âge qu’il paraissait.
Il ferma la porte et se rendit à la chambre où était sa femme.
« Dame, » dit-il, « dors-tu? » –
« Non, seigneur; je dormais, mais je me suis réveillée quand tu es entré. »
« Voici pour toi un fils, » dit-il, « si tu veux en avoir un qui n’a jamais été à toi. »
« Seigneur, qu’est-ce que cette aventure? »
« Voici. » Et il lui raconta toute, l’histoire.
« Eh bien, seigneur, » dit-elle, « quelle sorte d’habit a-t-il? »
« Un manteau de paile, » répondit-il.
« C’est un fils de gentilhomme. Nous trouverions en lui distraction et consolation, si tu voulais. Je ferais venir des femmes et je leur dirais que je suis enceinte. »
« Je suis de ton avis à ce sujet, » répondit Teyrnon. Ainsi firent-ils. Ils firent administrer à l’enfant le baptême alors en usage et on lui donna le nom de Gwri Wallt Euryn, (aux cheveux d’or) parce que tout ce qu’il avait de cheveux sur la tête était aussi jaune que de l’or.
On le nourrit à la cour jusqu’à ce qu’il eût un an. Au bout de l’année, il marchait d’un pas solide; il était plus développé qu’un enfant de trois ans grand et gros. Au bout d’une seconde année d’éducation, il était aussi gros qu’un enfant de six ans. Avant la fin de la quatrième année, il cherchait à gagner les valets des chevaux pour qu’ils le laissassent les conduire à l’abreuvoir.
« Seigneur, » dit alors la dame à Teyrnon, « où est le poulain que tu as sauvé la nuit où tu as trouvé l’enfant? »
« Je l’ai confié aux valets des chevaux, » répondit-il, « en leur recommandant de bien veiller sur lui. »
« Ne ferais-tu pas bien , seigneur, de le faire dompter et de le donner à l’enfant, puisque c’est la nuit même où tu l’as trouvé que le poulain est né et que tu l’as sauvé ? »
« Je n’irai pas là contre. Je t’autorise à le lui donner. »
« Dieu te le rende, je le lui donnerai donc. »
On donna le cheval à l’enfant; la dame se rendit auprès des valets d’écurie et des écuyers pour leur recommander de veiller sur le cheval et de faire qu’il fût bien dressé pour le moment où l’enfant irait chevaucher, avec ordre de la renseigner à son sujet.
Au milieu de ces occupations, ils entendirent de surprenantes nouvelles au sujet de Riannon et de sa pénitence. Teyrnon, à cause de la trouvaille qu’il avait faite, prêta l’oreille à cette histoire et s’en informa incessamment jusqu’à ce qu’il eût entendu souvent les nombreuses personnes qui fréquentaient la cour plaindre Riannon pour sa triste aventure et sa pénitence.
Teyrnon y réfléchit. Il examina attentivement l’enfant et trouva qu’à la vue, il ressemblait à Pwyll, chef d’Annwn, comme il n’avait jamais vu fils ressembler à son père. L’aspect de Pwyll lui était bien connu, car il avait été son homme autrefois.
Il fut pris ensuite d’une grande tristesse à la pensée du mal qu’il causait en retenant l’enfant lorsqu’il le savait fils d’un autre. Aussitôt qu’il trouva à entretenir sa femme en particulier, il lui remontra qu’ils ne faisaient pas bien de retenir l’enfant et de laisser ainsi peser tant de peine sur une dame comme Riannon, l’enfant étant le fils de Pwyll, chef d’Annwn.
La femme de Teyrnon tomba d’accord avec lui pour envoyer l’enfant à Pwyll.
« Nous en recueillerons, » dit-elle, « trois avantages : d’abord, remerciements et aumône pour avoir fait cesser la pénitence de Riannon; des remerciements de la part de Pwyll pour avoir élevé l’enfant et le lui avoir rendu; en troisième lieu, si l’enfant est de noble nature, il sera notre fils nourricier et nous fera le plus de bien qu’il pourra. » Ils s’arrêtèrent à cette résolution.
Pas plus tard que le lendemain, Teyrnon s’équipa avec ses chevaliers, lui troisième, son fils quatrième, monté sur le cheval dont il lui avait fait présent. Ils se dirigèrent vers Arberth et ne tardèrent pas à y arriver.
Ils aperçurent Riannon assise à côté du montoir de pierre. Lorsqu’ils arrivèrent à sa hauteur, elle leur dit : « Seigneur, n’allez pas plus loin; je porterai chacun de vous jusqu’à la cour c’est là ma pénitence pour avoir tué mon fils et l’avoir moi-même mis en pièces. »
« Dame, » répondit Teyrnon, « je ne crois pas qu’un seul de nous ici aille sur ton dos. »
« Aille qui voudra, » dit l’enfant, « pour moi, je n’irai pas. »
« Ni nous non plus, assurément, mon âme. » dit Teyrnon. Ils entrèrent à la cour, où on les reçut avec de grandes démonstrations de joie.
On commençait justement un banquet; Pwyll venait de faire son tour de Dyvet.
Ils se rendirent à la salle et allèrent se laver. Pwyll fit bon accueil à Teyrnon. On s’assit : Teyrnon, entre Pwyll et Riannon, ses deux compagnons plus haut, à côté de Pwyll, et l’enfant entre eux.
Après qu’on eut fini de manger et que l’on commença à boire, ils se mirent à causer. Teyrnon, lui raconta toute l’aventure de la jument et de l’enfant, comme l’enfant avait passé pour le sien et celui de sa femme, comment ils l’avaient élevé.
« Voici ton fils, princesse », ajouta-t-il, « ils ont bien tort ceux qui t’ont faussement accusée.
Quand j’ai appris la douleur qui t’accablait, j’en ai éprouvé grande peine et compassion. Je ne crois pas qu’il y ait dans toute l’assistance quelqu’un qui ne reconnaisse l’enfant pour le fils de Pwyll. »
« Personne n’en doute », répondirent-ils tous.
« Par moi et Dieu, mon esprit serait délivré de son souci (pryderi), si c’était vrai. »
« Princesse, » s’écria Pendaran Dyvet, « tu as bien nommé ton fils, Pryderi; cela lui va parfaitement : Pryderi, fils de Pwyll, chef d’Annwn. »
« Voyez, » dit Riannon, « si son propre nom à lui ne lui irait pas mieux encore ».
« Quel nom a-t-il ? » dit Pendaran Dyvet.
« Nous lui avons donné le nom de Gwri Wallt Euryn. »
« Pryderi sera son nom, » dit Pendaran.
« Rien de plus juste, » dit Pwyl, « que de lui donner le nom qu’a dit sa mère, lorsqu’elle a eu à son sujet joyeuse nouvelle. » On s’arrêta à cette idée.
« Teyrnon, » dit Pwyll, « Dieu te récompense, pour avoir élevé cet enfant jusqu’à cette heure; il est juste aussi que lui-même, s’il est vraiment noble, te le rende. »
« Seigneur, » répondit-il, « pas une femme au monde n’aura plus de chagrin après son fils que la femme qui l’a élevé n’en aura après lui. Il est juste qu’il ne nous oublie ni moi ni elle pour ce que nous avons fait pour lui.»
« Par moi et Dieu, » répondit Pwyll, « tant que je vivrai, je te maintiendrai, toi et tes tiens, tant que je pourrai maintenir les miens à moi-même. Quand ce sera son tour, il aura encore plus de raisons que moi de te soutenir. Si c’est ton avis et celui de ces gentilshommes, comme tu l’as nourri jusqu’à présent, nous le donnerons désormais à élever à Pendaran Dyvet. Vous serez compagnons, et pour lui, tous les deux, pères nourriciers. »
« C’est une bonne idée, » dit chacun.
On donna donc l’enfant à Pendaran Dyvet.
Les nobles du pays partirent avec lui. Teyrnon Twryv Vliant et ses compagnons se mirent en route au milieu des témoignages d’affection et de joie. Il ne s’en alla pas sans qu’on lui eût offert les joyaux les plus beaux, les chevaux les meilleurs et les chiens les plus recherchés, mais il ne voulait rien accepter.
Ils restèrent ensuite dans leurs domaines.
Pryderi, fils de Pwyll, chef d’Annwn, fut élevé avec soin, comme cela se devait, jusqu’à ce qu’il fut le jeune homme le plus agréable, le plus beau et le plus accompli en toute prouesse qu’il y eût dans tout le royaume. Ils passèrent ainsi des années et des années, jusqu’au moment où le terme de l’existence arriva pour Pwyll, chef d’Annwn.
Après sa mort, Pryderi gouverna les sept cantrevs de Dyvet d’une façon prospère, aimé de ses vassaux et de tous ceux qui l’entouraient.
Ensuite, il ajouta à ses domaines les trois cantrevs d’Ystrat Tywi et quatre cantrevs de Ceredigyawn : on les appelle les sept cantrevs de Seisyllwch.
Il fut occupé à ces conquêtes jusqu’au moment où il lui vint à l’esprit de se marier. Il choisit pour femme Kicva, fille de Gwynn Gohoyw, fils de Gloyw Wallt Lydan, fils de Casnar Wledic, de la race des princes de cette île.
Ainsi se termine cette branche des Mabinogion.
Traduction française de Joseph Loth, publiée en 1913.
Image ARAWN : http://mabinogistudy.com/library/pwyll-and-arawn/