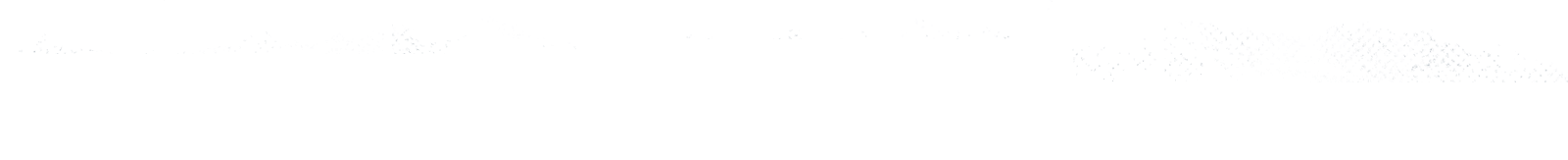Folklore
Il est triste de voir que, depuis l’époque chrétienne, on craint Mère-Sureau, qui a sans doute été autrefois une puissante figure féminine vénérée pour les propriétés guérisseuses de son arbre, comme si elle était une sorcière. En Irlande, on croyait que les sorcières utilisaient des branches de sureau comme des chevaux magiques, alors qu’en Angleterre, on disait que l’arbre aux branches tortueuses était une vieille sorcière courbée qui saignait quand on la coupait.
Un conte populaire du Somerset au sujet d’une sorcière sureau mérite d’être raconté ici. Il explique qu’un fermier découvrit un jour que ses vaches avaient été traites par une sorcière déguisée en sureau. Le fermier chargea son fusil avec une balle en argent pour la tuer mais il la manqua et la sorcière le pourchassa jusqu’à sa chaumière. Il se précipita alors par la porte d’entrée et sa femme avait bien tiré le verrou de fer mais le fermier se prit le bas du manteau dans la porte et se débattit pathétiquement là pendant que la sorcière rôdait à l’extérieur ! Heureusement, la vieille grand-mère sauva la situation. Elle prit : une pelle de charbon ardents et elle dit à sa fille : « Ouvre la porte de derrière toute grande ! Celle-ci s’exécuta et revint en courant vers sa mère, mais la Grand-mère ne bougea pas et quand la sorcière-sureau s’approcha d’elle en bondissant et en criant, celle-ci se leva et lui jeta tous les charbons ardents à la figure, puis elle rentra et ferma la porte derrière elle. C’est alors qu’ils virent tous des flammes bleues vaciller et entendirent l’arbre se réduire en cendres.
Au bout d’un moment, la Grand-mère prit la canne à vaches en frêne et sortit ; elle vit un tas de cendres déjà froid. Les deux femmes dessinèrent un quadrillage sur les cendres avec le bâton en frêne, puis elles coururent ouvrir la porte d’entrée de nouveau pour libérer le manteau du fermier qui put ainsi aller voir ses vaches.
Une sorcière-sureau figure dans la légende des célèbres Rollright Stones dans l’Oxfordshire. Un roi et son armée parcourait le pays quand une sorcière s’approcha et le défia :
Sept longues enjambées tu feras
Si tu peux arriver jusqu’à Long Compton
Tu seras roi d’Angleterre.
Aujourd’hui, le village de Long Compton est juste caché derrière un monticule bas appelé « le tertre de l’archidruide ». Après que le roi eut fait ses sept enjambées, la sorcière cria :
Long Compton,tu ne l’as pas vu
Roi d’Angleterre tu ne seras plus.
Lève-toi bâton et lève-toi pierre,
Car tu ne seras pas Roi d’Angleterre
Toi et tes hommes : des pierres givrées serez
Et moi en vieux sureau transformée.
Le roi devint la pierre solitaire appelée la Pierre du Roi, alors que ses hommes, blottis les uns contre les autres devinrent les « chevaliers qui murmurent », un groupe de cinq pierres à l’est. Le cercle de pierre lui-même est appelé « les Hommes du Roi ».
La réputation du sureau empira avec une légende chrétienne qui affirmait que le crucifix avait été fait de son bois et que Judas s’était pendu à un sureau. Un vieux chant de Noël appelé « les Douze Apôtres » raconte l’histoire et, dans le dernier vers, dénonce le sureau, qui se tient à l’écart des autres arbres (tout groupe d’arbres était appelé familièrement les « Douze Apôtres »).
Les douze apôtres étaient là
Les racines dans la rivière, et les feuilles dans le ciel,
les bêtes prospèrent toutes où qu’elles soient.
Mais Judas était pendu à un sureau
Et, en Écosse, là où le sureau est appelé « arbre-chambre des morts », un vieux poème fait remarquer que la petite stature de l’arbre et ses branches tordues sont la punition pour son rôle dans la mort de Jésus :
Arbre où résident les morts aux branches assassines,
Jamais droit et jamais fort,
Pour toujours buisson et jamais arbre,
Depuis que notre Seigneur y fut cloué
L’arbre tant décrié devint ensuite synonyme du Diable lui-même. De nombreuses personnes refusaient de faire brûler des bûches de sureau de peur de « faire entrer le Diable dans la maison ». Aubrey raconte une histoire amusante à ce sujet : un « bon vieux monsieur » appelé Mr. Allen, avait la réputation d’être un sorcier. Ce monsieur avait acquis une montre à une époque où de tels instruments étaient rares. Quand un couple de domestiques entrèrent dans sa chambre et entendirent la montre faire tic-tac dans son étui, ils pensèrent que ça devait être son familier ou même le Diable lui-même. Ils la prirent par la chaîne et la jetèrent par la fenêtre dans les douves, dans l’espoir de le noyer. Mais, par chance, la chaîne s’accrocha à un sureau qui poussait sur la rive, ce qui confirma leur opinion que c’était réellement un instrument du Diable ! Heureusement, cela permit à Mr. Allen de récupérer sa montre.